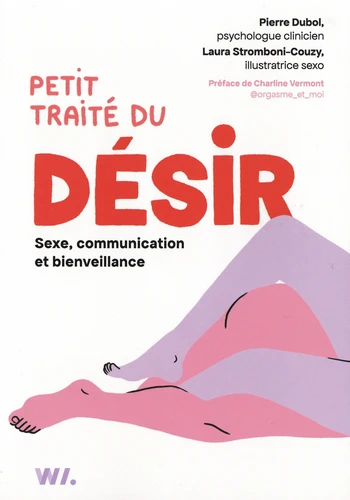Pour parler du sujet de sexualité et d’intimité des personnes en situation de handicap et notamment celles suives et/ ou résidentes d’établissements spécialisés dans le soin et l’accompagnement, Hop’Toys a donné la parole à Pierre Dubol, Psychologue Clinicien spécialisé dans les Thérapies Cognitives Comportementales et Émotionnelles. Connu sur les réseaux et notamment sur Instagram sous le pseudonyme de SexoPsycho.
Le but de cet article est de mettre les mots justes (parfois difficiles) sur une situation trop souvent tabouisée vécue par les personnes concernées avant tout et permettre aux responsables et au personnel soignant de se retrouver sur cette observation du terrain.
Professionnel·les, cet article est à vous, partagez-le.
Familles, cet article peut être envoyé aux institutions.
Personnes concernées, nous sommes avec vous, on vous voit, vous êtes légitimes, vos besoins et vos envies doivent être respectés et entendus.
La suite de l’article est rédigé par Pierre Dubol :
Laissez-moi vous raconter une histoire, comme il en existe des centaines par an, dans les instituions qui accueillent des personnes en situation de handicap moteurs et/ou psychiques.
Contexte
Nous sommes quelques années avant le confinement. J’ai la chance de passer un entretien d’embauche dans un établissement qui accueille des personnes TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) et ayant des troubles thymiques (Trouble de la Personnalité Borderline, Bipolaire, etc.). Cette association permet à ces adultes de 18 à 99 ans d’avoir des activités variées au cours de la journée, et un foyer le soir pour vivre en compagnie d’éducateur.ice.s spécialisé.e.s, d’animateur.ice.s et d’infirmier.e.s. C’est clairement le genre de lieu qui mérite bien plus de lumières (et de moyens) pour profiter pleinement à des personnes qui n’ont souvent aucune autre option pour parcourir leur quotidien en toute sécurité, et ce, dans un collectif stimulant.
Durant cet entretien, il m’est clairement présenté sur la fiche de poste, qu’il sera question d’accompagner les résidents sur la question de la sexualité. Cela fait suite à « des drames passés ». Je vous en parle plus bas dans cet article (tout en changeant quelques éléments afin que l’anonymat soit bien préservé pour toutes les personnes concernées).
Nous avons pris une trentaine de minutes pour évaluer les différentes missions et plusieurs fois, on me repose la question : « vous pouvez les aider pour le sexe, hein ? ».
Face à l’insistance, je questionne leurs attentes mais la seule réponse que j’obtiens est : « c’est vous le pro, vous verrez vite tout ce qu’il y a à bosser avec certains ».
A cette époque-là, jeune Psychologue, je ne perçois pas encore l’importance de demander plus de détails, ceux-ci viendront par la suite. Et ce, très rapidement.
Prise de poste
Suite à ma prise de poste, nous avons beaucoup de projets à retravailler n’ayant pas eu de prédécesseur présent pendant une longue période. La sexualité passe à la trappe, pendant un temps. Un mois plus tard, c’était un vendredi après-midi (je m’en souviens comme si c’était hier).
Je décide profiter d’un temps calme dans mon bureau pour aller chercher le projet de service et lire les écrits concernant l’intimité et les échanges relationnels autorisés entre les personnes accompagnées. Je parcours le long document que je trouve très explicite sur un nombre incalculable de point, mais bien forcé de constater que je n’arrive pas à mettre la main sur les textes qui m’intéressent.
Je profite alors que la cheffe de service est en train de s’en aller et qu’elle passe dans le couloir pour l’interpeler et lui demander de bien vouloir prendre cinq minutes avec moi. Très disponible et bienveillante, elle répond à toutes mes questions ; les réponses me laissant complètement assommé.
A la question « est-ce que les résidents ont le droit d’avoir des amoureux.ses, des bisous, des câlins dans certains temps dans la journée ? », elle me répond qu’ils n’ont pas le droit pendant la journée, ça perturberait les activités. Bon, j’entends.
A la question « est-ce que les résidents ont le droit d’avoir ces échanges relationnels dans leur lieu de vie, les foyers ? », elle me répond qu’ils n’ont pas le droit dans les espaces communs, pour ne pas déranger les autres résidents. Bon, j’entends.
A la question « les résidents ont donc la possibilité de faire cela dans leurs chambres respectives ? », elle me répond qu’ils ont interdictions d’aller dans les chambres des un.e.s et des autres, c’est un espace personnel et privé. Attendez…
La situation
Donc, si on résume la situation : nous avons des personnes accompagnées qui, si elles ont un amoureux ou une amoureuse (avant même de définir ce que l’on met derrière ce terme de proximité), elles ne peuvent pas exprimer ce lien par des bisous, des câlins, ni la journée, ni pendant les pauses, ni dans leur lieu de vie, ni dans leur chambre.
Conclusion, elles n’ont absolument aucun endroit pour exprimer ce besoin primaire de contact affectif sous peine d’un rappel à l’ordre. Mais pourquoi m’avait-on recruté au préalable pour parler sexualité s’il n’y a aucun lieu pour l’encadrer, le rendre sécurisé ?
Pour la première fois d’une longue liste, je constatais un établissement qui ne souhaitait pas réfléchir l’intimité des personnes handicapées, mais bien de l’annihiler pour ne pas avoir à subir « les problèmes » que cela peut générer.
Le tabou, le silence, l’obscurantisme étaient partout autour de ces résidents qui n’ont pas mis longtemps à déposer le sujet en consultation individuelle :
Les mots ont commencé à être mis
« Je voudrais bien une petite-copine, t’a une petite-copine toi ? », « la nuit, ça me gratte en bas et ça fait du bien », « avec lui, on s’aime, mais faut pas qu’on le dise sinon on va nous changer de groupe, tu dis pas hein !? ». C’est l’un des premiers témoignages que j’ai pu recueillir après la découverte étouffante du (non-)projet de service.
Après un long travail de verbalisation et en recevant l’autre résident qui me confirmait cet amour naissant et la peur que l’équipe le découvre, ils m’ont fait promettre de pas changer de groupe si j’en parlais en réunion avec les éducateur.ice.s. Une fois la promesse obtenue de la part des équipes, j’ai évoqué la situation et la nécessité d’en faire notre situation-test, afin de réguler petit à petit cette nouvelle vision de l’intimité au sein de l’institution.
Face à moi, des professionnel.le.s extrêmement compétent.e.s et bienveillant.e.s, mais pétrifié.e.s à l’évocation du sujet. Personne ne prend la parole et tout le monde se renvoie la balle. C’est à cela que ressemble un tabou à petite échelle, tout le monde est contaminé et la peur gagne toutes les anticipations au changement. La cheffe d’établissement me dit qu’on en parlera dans son bureau après la réunion. A ce moment-là, je m’attends à un blâme, je suis jeune et peu affirmé.
TW : mutilation
L’histoire que la cheffe de service m’a racontée est assez choquante et je vous invite à sauter le prochain paragraphe, si vous n’êtes pas dans un bon jour. Si je me permets de donner cet exemple, c’est avant tout parce que quand on parle des conséquences du silence et du tabou sur la sexualité dans le milieu du handicap, les gens ont tendance à se dire : « oui, oui, j’imagine bien, oui », mais ce récit permet de constater que non, la plupart du temps, la réalité va au-delà du simple ressenti.
Une résidente qui n’était plus là mon arrivée, avait 22 ans et beaucoup de verbalisation sur la sexualité. Elle avait plusieurs fois été signalée dans la chambre d’autres résidents et rappelée à l’ordre en présence de ses parents.
Elle pouvait facilement dire qu’elle ressentait des envies pour des garçons et aimait beaucoup quand ils lui faisaient des câlins. Problème, ce discours était souvent suivi de remarque de l’équipe du moment.
Exemple : « roh calme-toi, c’est pas bien de dire des trucs comme ça ».
NB : j’avais remarqué plusieurs résident « homme » avoir eu ce genre de paroles, depuis mon arrivée, et cela portait plus à la rigolade, qu’à la critique, je pose ça là.
La famille est à nouveau convoquée pour parler du sujet, mais surtout pour prévenir que ses comportements ne vont pas pouvoir être acceptées longtemps si la situation n’évolue pas. La famille, suite à cela, cherche des solutions de leurs côtés, sans forcément échanger davantage avec l’établissement sur leurs idées.
Une de ces idées consistaient à lui offrir un Sex-toy, dans le but que « peut-être, ça puisse la calmer en se faisant du bien avec ».
Lors de cet achat, cette famille a réfléchi en autonomie (pour ne pas dire en secret) sur quel objet lui offrir.
Les jouets avec piles, mis de côtés parce que « surement trop compliqué pour elle ».
Les jouets sur batterie, mis de côtés parce que « si elle l’utilise pendant la nuit et qu’un éducateur l’entend, elle va être grondée ». Le jouet choisi était donc un Sex-toy en verre. Problème, la résidente avait de fortes gestuelles stéréotypiques (balancement, spasmes des bras et jambes, etc).
L’équipe n’était pas au courant de cette possession dans sa chambre.
Un jour, elle a eu un geste trop proche d’un meuble et avec la force, le jouet s’est cassé. Sauf, que sans éducation sexuelle, sans accompagnement sur les bons usages de ces objets (d’ailleurs souvent les toys en verre sont réservés à des personnes déjà bien habitués à ce type de jeu), sans communication sur les pratiques les plus adaptées en fonction des besoins des personnes et de leur handicap… cette jeune femme a utilisé le jouet en verre malgré la partie cassée et tranchante.
On comprend mieux pourquoi un silence supplémentaire est venu s’abattre sur ces professionnel.le.s de l’accompagnement. Le message collectif retenu : « Sexe chez nos résident.e.s = DANGER ».
Un message clair
A moins d’avoir une pathologie en lien avec le trouble du désir, que l’on veuille ou non : les personnes en situation de handicap ont naturellement des envies.
C’est normal. Ce qui ne l’est pas, c’est de poser un voile sur ce sujet pour ne pas prendre de risque. Les risques sont pris lorsque l’on décide de ne pas en parler, de ne pas avoir un véritable projet d’accompagnement sur le sujet.
Si vous êtes quelqu’un qui accompagne ou proche d’une personne en institution, osez évoquer le sujet avec les équipes. Osez proposer des formations que vous avez repéré sur internet. Osez faire valoir le droit fondamental à disposer de son corps et à être accompagné.e vers l’auto-déterminisme/ l’autodétermination dans l’intimité et la vie affective. Des solutions existent, des personnes sont formées pour vous aider, n’ayez pas peur, n’ayez pas honte. L’intimité est un sujet aussi important que l’appétit, le sommeil ou l’hygiène.
J’espère que malgré la vibration que cet article vous a peut-être fait ressentir, vous en repartirez avec un cœur conquérant et non abattu. Les choses bougent, les établissements évoluent et bientôt, tous ces tabous seront derrière nous. ON Y CROIT !
Hop’Toys remercie chaleureusement Pierre Dubol pour cette prise de parole.
Retrouvez-le sur Instagram et si vous voulez en lire davantage, son ouvrage « Petit traité du Désir » illustré par MyDearVagina est disponible en librairie.