Comprendre et agir face aux moqueries et au harcèlement, sans culpabiliser les enfants
« T’es bizarre », « Pourquoi tu parles comme ça ? », « T’as vu comment elle marche ? »
Dans la cour de récréation, les mots peuvent devenir des armes.
Des remarques souvent minimisées, qui isolent, humilient, blessent. D’autant plus lorsque cela est répété.
Qu’elles soient dirigées contre un enfant neurodivergent, en situation de handicap, trop grand, trop petit, trop silencieux ou tout simplement différent, les moqueries ne sont pas des anecdotes. Elles sont le terreau d’un mal plus profond : le harcèlement.

Dans cet article, nous vous proposons des repères concrets, sans culpabilisation, pour comprendre, prévenir et agir face au harcèlement. Car chaque enfant a le droit fondamental d’évoluer dans un environnement sûr, respectueux et inclusif.
Moquerie, conflit ou harcèlement ? Identifier pour mieux agir
Avant tout, posons les mots justes. On confond souvent :
- Une moquerie isolée : une remarque blessante ponctuelle, qui reste marginale dans les interactions sociales. Qui peut tout de même faire mal.
- Un conflit : un désaccord ou une tension entre enfants, sans déséquilibre de pouvoir durable. Le conflit est acceptable, la violence ne l’est pas !
- Le harcèlement : des agressions (verbales, physiques, sociales, en ligne…) répétées, intentionnelles, avec une dynamique de domination. L’enfant ciblé est souvent isolé, dans l’incapacité de se défendre seul.

Un enfant moqué régulièrement, exclu, ridiculisé, mis à l’écart ou dont on se moque de manière récurrente est potentiellement victime de harcèlement. Ce n’est jamais “juste pour rire”.
Et quand la cible est un enfant handi ou avec des besoins spécifiques, les risques sont amplifiés :
- Parce qu’il communique différemment
- Parce qu’il ne perçoit pas toujours les codes sociaux implicites
- Ou parce que son corps ou ses comportements sortent des “normes” attendues par les pairs
Ce n’est pas à lui de juste “s’adapter”. C’est au groupe, à l’école, à l’environnement d’agir face au harcèlement et de se rendre accessible, tolérant et protecteur.
Pas de sa faute
Une erreur fréquente consiste à chercher une cause chez l’enfant victime.
« Il est peut-être trop sensible », « Elle doit réagir différemment », « Il attire les moqueries sans le vouloir »…

Stop !
Ce n’est jamais à la personne moquée de s’adapter au comportement de celui qui se moque.
Le risque, en pensant comme ça, c’est de renforcer l’idée que “si ça m’arrive, c’est que je l’ai cherché”. On glisse alors vers une forme de culpabilité intériorisée, destructrice pour l’estime de soi. Et qui peut suivre tout au long de la vie.
Ce mécanisme peut se doubler d’une confusion douloureuse : “Est-ce que ma différence mérite qu’on se moque de moi ?”
La réponse est claire : NON. Et il ou elle a le droit d’attendre un environnement qui protège et valorise sa singularité.
Il est essentiel de changer de posture : le problème n’est pas chez l’enfant moqué·e, mais dans l’environnement qui autorise ou tolère ces moqueries.
Il faut inverser cette logique et agir clairement face au harcèlement en lui renvoyant un message clair :
“Ce que tu vis est injuste, ce n’est pas à toi de t’adapter. Tu mérites d’être respecté comme tu es.”
Incarnez, en tant qu’adulte, le cadre rassurant.
Dans le harcèlement, personne n’est neutre. Pour une personne harcelée, on est soit « avec » soit « contre » les harceleurs.
Le témoignage de Nathan Smadja, fondateur de l’association Resiste : Il parle du harcèlement qu’il a subit et rapporte la parole d’une mère de victime :
C’est compliqué parce que, au bout d’un moment, j’avais l’impression que tout le monde était complice du harcèlement que je pouvais subir.
Je me souviens aussi d’une mère de famille qui me parlait du harcèlement qu’avait subit sa fille. Elle pensait que ses propres parents étaient complices et d’accord avec le harcèlement qu’elle pouvait subir dans la cour de récréation justement parce qu’ils ne disaient rien et ne s’étaient positionnés clairement.
Identifier les signes : quand l’enfant ne dit pas avec des mots, mais avec son corps ou son comportement
Tous les enfants ne racontent pas ce qu’ils vivent. Et certains, peut-être non verbaux, ne le peuvent tout simplement pas. C’est à nous, adultes, d’être attentifs aux signaux faibles :
- Changements soudains d’humeur (tristesse, colère, irritabilité)
- Troubles du sommeil ou de l’alimentation
- Refus / angoisse d’aller à l’école ou à certaines activités
- Isolement social, perte de joie
- Crises plus fréquentes ou régressions dans certains apprentissages

Le jeu peut devenir un canal d’expression puissant.
En jouant à “l’école”, en utilisant des figurines ou marionnettes, l’enfant peut rejouer des scènes.
L’observation attentive de ces interactions peut révéler bien plus qu’un long discours.
Même seul·e, l’enfant exprime souvent beaucoup à travers la mise en situation avec ses jouets.
Regardez comment il ou elle joue, ce qui est exprimé.
Recréez, dans un environnement pour « sûr » (à la maison) ce qui peut se passer ailleurs pour défaire le fil et comprendre ce qui peut se passer pour illustrer l’adulte qui est là pour agir face au harcèlement.
Important : Vous avez aussi le droit de ne pas tout savoir et vous faire aider ! Les psys, les pédopsys sont aussi là pour ça. Les psychomotricien·ne et ergothérapeutes décèlent également parfois une situation problématique qui pourrait se passer à l’école.
Harcèlement en ligne : quand l’école se prolonge derrière l’écran
Le harcèlement ne s’arrête pas toujours à la sortie de l’école.
Les moqueries, insultes, humiliations et intimidations peuvent se poursuivre sur les réseaux sociaux, les messageries, les jeux en ligne. On parle alors de cyberharcèlement.

C’est une forme de violence particulièrement pernicieuse, car elle envahit l’espace intime, même à la maison. Elle est souvent anonyme ou indirecte (groupes privés, photos partagées, stories détournées). Elle peut être permanente sans possibilité d’échappatoire et surtout, elle laisse des traces durables.
Le cyberharcèlement n’est pas un phénomène “à part” : il est souvent le prolongement direct du harcèlement scolaire.
Un enfant déjà ciblé à l’école devient la cible idéale dans un groupe WhatsApp de classe ou sur un serveur de jeu, sur Snapchat, Insta, Discord, etc.
« Même à la maison, ils m’envoient des messages », « Ils font des montages avec ma photo », « Ils créent un faux compte avec mon nom. »

Quelques chiffres clés à connaître :
- En France, 1 enfant sur 10 a déjà été victime de cyberharcèlement (source : e-Enfance / Educonnect, 2023).
- Chez les adolescents de 13 à 17 ans, ce chiffre grimpe à 1 sur 5.
- Dans plus de 80 % des cas, les auteur·ices sont connu·es de la victime (souvent des camarades de classe).
- Le cyberharcèlement est particulièrement violent envers les enfants perçus comme différents : en situation de handicap, LGBTQIA+, racisés, en surpoids, etc.
- Les enfants en situation de handicap sont plus exposés aux violences en ligne, souvent en raison de leurs particularités de communication ou d’un usage des outils numériques sans accompagnement adapté.
Que faire en cas de cyberharcèlement (conseils pour les enfants et ados) ?
- Conserver les preuves (captures d’écran, messages, comptes)
- En parler immédiatement à un adulte de confiance
- Signaler les contenus aux plateformes concernées
- Contacter le 3018, accessible par téléphone, chat en ligne ou via l’application mobile.
Le 3018 peut également bloquer et faire retirer rapidement des contenus en ligne grâce à un partenariat avec les grandes plateformes (Snapchat, Instagram, Discord, etc.).
Le dispositif PHAROS permet également de faire un signalement relatif à un contenu illicite en ligne.
Comment réagir en tant qu’adulte ? Accueillir, protéger, agir
Face à la révélation (même partielle) d’un harcèlement, voici les priorités :
L’enfant prend un risque en parlant (c’est perçu comme tel). Il faut lui garantir qu’il sera entendu, sans être jugé, sans être interrompu.
« Tu fais bien de m’en parler. Ce que tu ressens est valide et légitime. Tu n’es pas seul·e. »

Valider ses émotions
Même si ce qui est raconté semble “petit”, l’impact émotionnel peut être immense. Ce n’est pas le fait qui prime, mais la souffrance qu’il génère.
Ne pas le responsabiliser
Éviter à tout prix des phrases comme :
- “Tu n’as qu’à les ignorer.”
- “Réponds-leur par une blague.”
- “C’est juste pour rigoler, ça va passer.”
Ce type de réponse nie la violence subie et renvoie l’enfant à une solitude encore plus grande.
Agir concrètement face au harcèlement
- Informer l’école, de manière formelle si besoin.
- Demander la mise en œuvre du protocole de traitement du harcèlement scolaire (obligatoire depuis la loi de 2021).
- Contacter le numéro 3018 (anonyme, gratuit, confidentiel).
- En cas de handicap, mobiliser aussi la MDPH, l’équipe de suivi de scolarisation, l’AESH si présent·e.
Et si c’est mon enfant qui se moque ? Un malaise à explorer, pas une honte à cacher
Aucun parent n’a envie d’entendre que son enfant blesse. Mais nier, minimiser ou se braquer ne sert personne : ni l’enfant ciblé·e, ni celui ou celle qui harcèle.

Derrière un comportement de harcèlement se cache souvent un besoin de contrôle, un mal-être, une insécurité ou une dynamique de groupe toxique.
Des violences subies, vécues, vues, banalisées peuvent mener à la reproduction de celles-ci.
Notre rôle d’adulte, c’est de :
- Recadrer clairement : “Ce que tu fais n’est pas acceptable. Cela fait souffrir.”
- Chercher à comprendre sans excuser.
- Travailler sur les émotions, les représentations, l’empathie.
- Lire des histoires, jouer, parler de la différence sans tabou.
- Faire appel à un·e professionnel·le (psychologue, médiateur·ice scolaire…).
Et si l’enfant se moque d’un camarade en situation de handicap, c’est d’autant plus urgent de nommer les choses : pourquoi cette différence l’interroge-t-elle ?
Qu’a-t-il appris dans son environnement (famille, télé, école…) sur le handicap ?
Et surtout : qu’est-ce qu’il n’a pas encore appris ?
Des ateliers de sensibilisation peuvent être demandés et organisés à l’école. Approchez-vous de l’équipe pédagogique et/ ou des représentant·es des parents d’élèves.
Agir à la racine : éduquer, prévenir, transformer
Le harcèlement ne disparaît pas avec des slogans. Il se combat en amont :
- En cultivant une culture de la coopération, pas de la compétition
- En instaurant des espaces de parole réguliers (cercle de parole, météo des émotions, débats philosophiques…)
- En valorisant la diversité
- En rendant visibles les représentations minorées dans les livres, les jeux, les affiches
- En outillant tous les enfants pour qu’ils puissent demander de l’aide
- Et en formant les adultes (enseignant·es, animateur·ices, personnel scolaire) à détecter et agir vite
Une école inclusive ne se limite pas à l’accueil des enfants. Elle change et s’adapte pour que chacun·e puisse y grandir sereinement.
Créer un cadre protecteur à l’école
Un enfant ne devrait jamais avoir à se défendre seul·e.
Ce qui le protège, au-delà d’un adulte bienveillant, c’est un cadre collectif clair et cohérent.

Une école protectrice, c’est une école où
Le respect est la norme,
La coopération est valorisée,
La parole des enfants est écoutée.
Cela implique une présence adulte visible et formée, des règles connues et portées par tous, et des temps réguliers pour parler ensemble de ce qui se vit : émotions, conflits, malaises, relations.
Quand un climat d’écoute et de respect est installé durablement, les enfants savent qu’ils ne seront ni seuls, ni ignorés.
Et l’école devient enfin ce qu’elle devrait être :
Un espace où l’on apprend, mais surtout où l’on peut être pleinement soi-même.
Ressources utiles
Numéro national contre le harcèlement scolaire : 3018
Plateforme : https://www.3018.fr
Livres à lire avec les enfants :
- Ça fait mal la violence, Dr. Catherine Dolto
- Harcelés harceleurs, Dr. Catherine Dolto
- Les moqueries, non merci ! Mimi P.Black & judy S.Freedman
- Grrrr ! Comment surmonter ta colère, Elizabeth Verdick & marjorie Lisvoskis (pour parler des émotions et gérer sa colère)
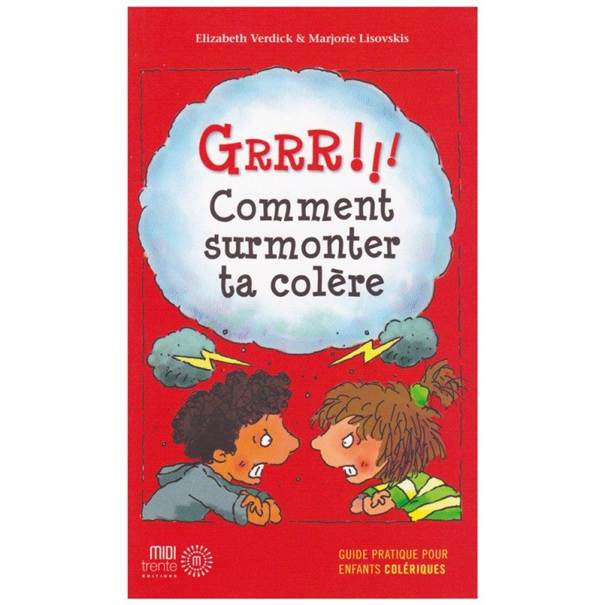
Jeux coopératifs recommandés :
- Feelings (pour parler des émotions)
- Emoticartes harcèlement (pour exprimer ce qu’on ressent)
- Dixit (pour ouvrir l’imaginaire et le dialogue)
Refuser la banalisation de la violence
Une moquerie est une violence
Se moquer n’est pas “normal”. Ce n’est pas un passage obligé de l’enfance. Et encore moins quand cela vise, de manière répétée, un enfant qui est déjà en situation de vulnérabilité.

C’est en refusant la banalisation, en agissant collectivement, en formant les adultes et en valorisant les différences que l’on construira une école (et une société) où chaque enfant, singulier et unique, pourra s’épanouir et se sentir en sécurité.
Et vous, avez-vous déjà été victime de moqueries, de harcèlement ? Votre enfant ? Parlez-en dans l’espace commentaires, vos témoignages sont précieux et vous n’êtes pas seul·es !
>> Affiche à télécharger : 10 conseils contre le harcèlement




