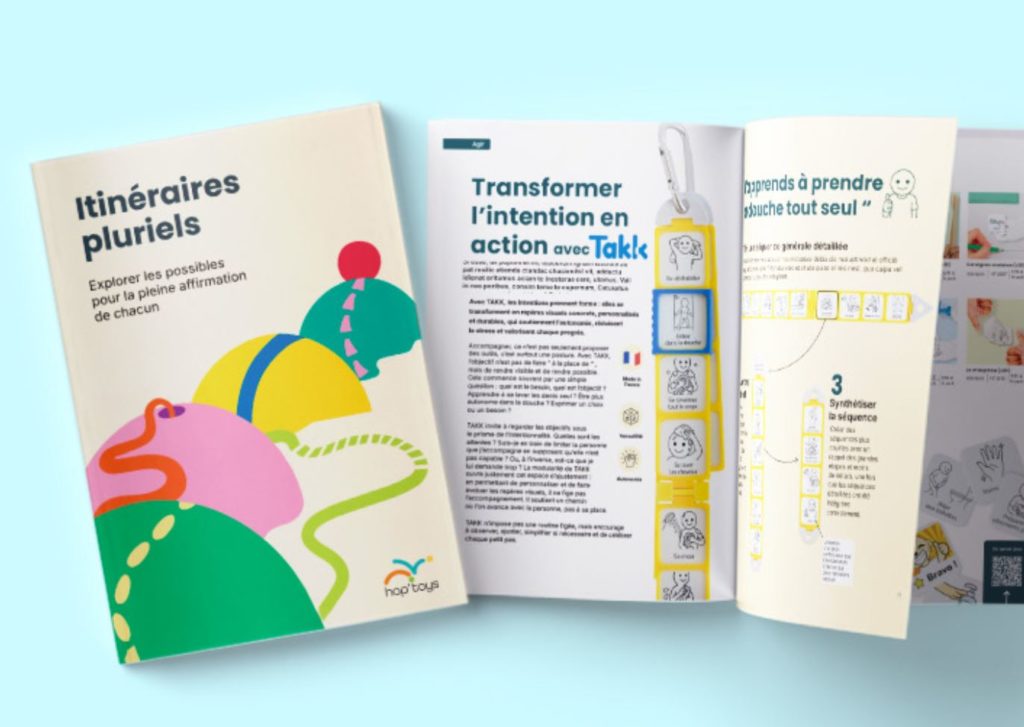Et si nos « bonnes intentions » n’étaient pas toujours suffisantes ? Dans la relation d’accompagnement, il ne suffit pas de vouloir bien faire. Ce qui compte, c’est aussi l’intentionnalité.
Avant même de parler d’objectifs, il y a deux mots qui paraissent proches mais qui n’ont pas le même poids : intention et intentionnalité.
L’intention, c’est le but que je vise : “je voudrais qu’il ou elle puisse utiliser son planning”, “je souhaite qu’il ou elle exprime une demande”.
L’intentionnalité, c’est la manière dont je vais m’engager pour aller dans cette direction. C’est la qualité de présence que je mets dans la relation : comment je me place, quelle conscience j’ai de mes biais, quelle place je laisse à la personne.
Cette distinction change tout. Parce qu’on peut avoir de “bonnes intentions”, mais si elles ne sont pas portées par une intentionnalité vigilante, elles peuvent enfermer, réduire ou imposer. L’intentionnalité, elle, oblige à se demander : “Suis-je en train d’accompagner, ou de limiter ? Est-ce que je pars de mes peurs, de mes croyances, ou vraiment de la personne en face de moi ?”
“Assume that I can”
La campagne CORE DOWN “Assume that I can” a été une vraie prise de conscience. En la découvrant, j’ai pris conscience de mes propres réflexes : combien de fois ai-je pensé protéger une personne en me disant, presque malgré moi, “ça, elle ne pourra pas le faire” ? Et puis, à l’inverse, combien de fois ai-je été tentée d’espérer trop vite, trop haut, en projetant mes attentes à moi plutôt que les siennes ? Ces deux mouvements – limiter ou exiger – partent souvent d’une bonne intention, mais dans les faits, ils peuvent éteindre la confiance, abîmer la relation et décourager autant celui qui accompagne que celui qui est accompagné.

Quand nos biais brouillent la boussole
L’équilibre est délicat. Et il est rendu encore plus complexe par nos biais cognitifs. Pour aller plus vite ou faire moins d’efforts, notre cerveau prend des raccourcis. Sans qu’on s’en rende compte, ils influencent la façon dont on se fixe des objectifs et lit les progrès
- Le biais du statu quo, qui nous fait maintenir des habitudes, même si elles ne sont plus aidantes.
- Le biais de confirmation, c’est quand on remarque surtout ce qui confirme ce qu’on pense déjà.
- La pensée polarisée, qui enferme dans le tout ou rien : réussite ou échec.
- Le biais des coûts engagés, c’est quand on continue dans une voie parce qu’on y a déjà investi du temps ou de l’énergie, même si elle ne fonctionne plus.
- L’effet de halo, où une difficulté dans un domaine colore toute notre perception de la personne.
- L’effet Dunning-Kruger, où l’on surestime notre capacité à évaluer ou accompagner.
- La généralisation excessive, qui transforme un échec isolé en vérité définitive.
- Le grossissement ou minimisation, qui déforme notre lecture des progrès.
SMART : une boussole concrète
Reconnaître ces biais ne nous rend pas parfaits, mais plus attentifs. Et c’est là que les objectifs SMART trouvent leur utilité. Ils ne sont pas une recette magique, mais une boussole. Ils nous obligent à préciser ce que nous attendons, à vérifier que c’est atteignable, à relier l’objectif à un besoin concret et à poser un cadre dans le temps.
Par exemple, quand nous utilisons des supports visuels, définir un objectif SMART, c’est choisir d’agir avec intentionnalité : éviter d’écraser la personne sous des attentes irréalistes. Refuser aussi de l’enfermer dans une vision trop limitée. C’est avancer pas à pas en laissant la personne actrice de son propre chemin.

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.
Antoine de Saint Exupéry
Ouvrir des possibles plutôt que fermer des portes
Au fond, accompagner, c’est entrer dans une relation. Et dans cette relation, il ne s’agit pas seulement de formuler des intentions, mais de réfléchir à la manière dont on les habite. L’intentionnalité peut devenir une boussole discrète : elle nous aide à rester attentifs, à éviter que nos “bonnes intentions” ne se transforment en murs, et à cultiver une posture d’ouverture.
Je crois que chacun de nous, dans son rôle d’accompagnant, peut choisir de se poser cette question simple : « Qu’est-ce que je peux faire aujourd’hui pour ouvrir une possibilité plutôt que de fermer une porte ? »